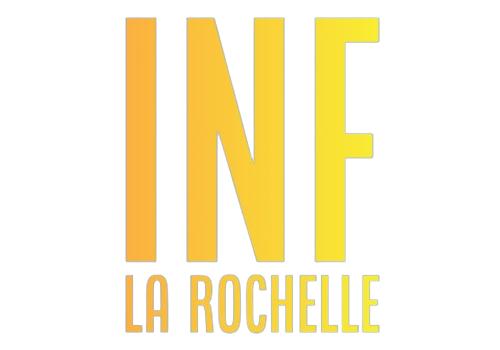À l’occasion de notre série sur l’usage des armes à feu au sein de la police, un ancien policier de la BRI, qui a fait face aux terroristes du 13 novembre au Bataclan et plusieurs grands bandits parisiens, nous livre son témoignage sur la gestion des armes, qui, même dans les situations les plus complexes, doit rester maîtrisée.

Surnommée « l’Antigang », la BRI (Brigade de recherche et d’intervention) est l’une des unités d’élite françaises les plus mythiques. Basée à Paris, cette brigade, d’abord connue pour ses interventions dans des affaires de grand banditisme et de gangs, a vu sa mission évoluer depuis 2015, notamment après la vague d’attentats qui a frappé la capitale. Les hommes de la BRI étaient en première ligne au Bataclan face aux deux terroristes, mais également en janvier 2015 lors de la prise d’otages de l’Hyper Cacher.
Après de nombreuses années passées au sein de ce service d’élite, Thomas, un policier, a accepté de témoigner* dans le cadre de notre série sur l’usage des armes à feu. Il a vécu l’ensemble des attentats parisiens et a travaillé sur de nombreuses affaires de grand banditisme, mais aussi sur des prises d’otages ou des interventions contre des forcenés, en utilisant parfois son arme lorsque sa vie ou celle d’autrui était menacée.
Comme il l’explique, même dans les cas les plus stressants ou les plus complexes, comme ce fut le cas le 13 novembre, l’usage des armes doit être réfléchi. Il ne peut pas se faire à la légère, au risque d’avoir des conséquences particulièrement graves pour ses collègues ou pour les personnes autour.
*(Thomas est un nom d’emprunt, utilisé pour garantir la confidentialité de l’identité du policier)
"Tirer sur les pneus d’un véhicule ne l’arrête jamais"
Thomas a fait usage de son arme à deux reprises dans des affaires de grand banditisme. La première intervention concernait une prise d’otages d’un comptable dans un hôtel où les braqueurs avaient forcé le coffre-fort et emporté l’argent. Après avoir détecté les mouvements des individus, la BRI avait mis en place un dispositif pour interpeller les suspects en flagrant délit. Installés dans le parking situé dans les sous-sols de cet hôtel de luxe parisien, les policiers d’élite devaient bloquer les deux accès du parking au moment où les malfrats remontaient.
Cependant, au moment où le dispositif était en place et que le véhicule arrivait, celui-ci a brusquement donné un coup de volant et a réussi à prendre la fuite. Thomas, qui était descendu de son véhicule, s’est retrouvé face aux malfrats qui fonçaient droit sur lui. Sans autre alternative et sans possibilité de se décaler, il a sorti son arme et fait feu à deux reprises. Un de ses collègues a également tiré, mais cette fois sur les pneus du véhicule. Comme l’explique Thomas, « tirer sur les pneus d’un véhicule ne l’arrête jamais ».
Comme vu dans notre premier épisode, il n’avait pas d’autre choix que de tirer, car il faisait face à une menace directe, ce qui entre dans le cadre de la légitime défense. Heureusement, il a réussi à se dégager et à éviter le véhicule, qui a failli lui écraser le pied. Il a tiré une troisième cartouche, pensant toucher le chauffeur. Le véhicule a été retrouvé 200 mètres plus loin, après avoir percuté un bus, tandis que les suspects ont été appréhendés quelque temps après. Thomas a dû répondre de son acte devant la cour d’assises, face à un célèbre avocat qui l’a « bien secoué », comme il le confie. Il a découvert par ailleurs que le chauffeur n’avait même pas été touché par son tir.
"Je me dis que s’il tire une balle, c’est fini pour moi. Quand j’en aurai tiré une, il en aura tiré vingt"
Comme l’explique Thomas, ce travail au sein de la BRI est parfois dur sur le plan psychologique, notamment sur l’aspect familial, avec des enfants « qui voient leur père risquer sa vie tous les jours », comme il l’explique. « Le jour de mon anniversaire, j’ai failli mourir et pourtant, quand je rentre chez moi, la vie continue. C’est assez particulier à vivre […] On est entraîné pour ça, il faut du caractère et ce n’est pas donné à tout le monde », confie-t-il. Une constante exposition à la mort, comme lors de sa seconde affaire, où il a fait usage de son arme après s’être retrouvé seul face à trois individus dont un armés en plein milieu d’une rue.
Après avoir détecté des mouvements suspects dans le cadre d’un dispositif de surveillance, Thomas quitte ce dernier pour suivre des individus. Après une filature en voiture, leur comportement suspect laissait penser qu’ils avaient commis un délit, explique l’ancien policier de l’« Antigang », qui décide de les interpeller. Ses collègues, également présents, prennent position en prenant le véhicule par la gauche pour les coincer en tenaille, mais les individus les percutent et les poussent sur le bas-côté. Seul, Thomas se retrouve à poursuivre les malfrats dans les rues parisiennes à vive allure.
Moins de cinq minutes plus tard, une « éternité » pour Thomas, les suspects se retrouvent bloqués par un camion poubelle. Seul face à trois hommes dans la voiture, Thomas analyse l’environnement et se retrouve braquer par un fusil mitrailleur tenu par l’un des individus, à travers la lunette arrière du véhicule devant lui. Se sentant bloqué, comme dans une cage, et avec l’effet tunnel, qui, avec le stress, diminue la vision, Thomas essaie de se concentrer sur le canon et prend la décision spontanée de sortir de son véhicule. « Je me dis que s’il tire une balle, c’est fini pour moi. Quand j’en aurai tiré une, il en aura tiré vingt»
En une fraction de seconde, il doit prendre une décision : soit, dans le cadre de la légitime défense, il tire dans la tête de l’individu avec le fusil mitrailleur, soit il tire sur la carrosserie pour toucher le corps sans tuer. Fort de son expérience dans la première affaire cité dans l’article, il choisit la seconde option : les balles traversent la carrosserie. Les malfrats prennent la fuite et leur véhicule accidenté est retrouvé plus loin, contenant une grenade, des bijoux et un fusil mitrailleur. Ils s’enfuient en prenant en otage une personne venue leur porter secours avec son véhicule.
Une procédure est ouverte par la police des polices, l’IGPN, qui classe rapidement le dossier. Une procédure judiciaire suit, Thomas étant considéré comme victime car il a été menacé par une arme. Les individus seront retrouvés quelques mois plus tard, dont l’un des trois, particulièrement connu des forces de l’ordre pour sa dangerosité.
"On intervient avec cette image de la mort au Bataclan"
Enfin, pour illustrer un dernier exemple sur l’usage des armes, Thomas a tenu à nous raconter son expérience lors de l’intervention au Bataclan, le 13 novembre 2015. Ce soir-là, trois jihadistes de Daesh ont tué 90 spectateurs dans la salle de concert, tandis que plusieurs autres commandos commettaient plusieurs tueries à Paris. En tout, 130 personnes seront assassinées en quelques heures, dans les attentats les plus meurtriers que la France ait connus.
Lorsque Thomas et la BRI arrivent sur les lieux, l’opérateur et instructeur du groupe d’élite se retrouve face à un véritable tapis de morts et de blessés. « On intervient avec cette image de la mort au Bataclan », raconte-t-il, décrivant une forte odeur de fer, une sorte de fumée, et une chaleur moite « comme dans une discothèque ». Il poursuit : « C’était hyper désagréable et terrible. On nous agrippait les jambes pour qu’on porte secours aux blessés par terre, mais on avait la mission de neutraliser les terroristes. J’avais cette sensation d’être un animal à sang froid. »
L’objectif : libérer les otages retenus dans un couloir à l’étage. La colonne de la BRI se positionne en hauteur, sur la balustrade surplombant la scène, afin de donner l’assaut. « Une porte nous séparait des terroristes. C’était la situation la plus délicate sur le plan tactique. On se bat en tant que formateur pour qu’on ne soit jamais exposé à des incidents dans des couloirs », explique Thomas. Face à des terroristes déterminés à mourir et au contact immédiat des otages, les armes doivent être adaptées. « Est-ce que le couloir est piégé ? Quelle arme utiliser pour l’assaut ? », se demande-t-il.
Il choisit alors une grenade offensive contenant 40 grammes d’explosif. Elle ne projette pas d’éclats, mais produit une puissante détonation pouvant tuer dans un rayon de deux mètres. Quand l’ordre d’assaut est donné, les hommes de la BRI pénètrent dans le couloir, jetant la grenade pour surprendre les terroristes sans toucher les otages. Ces derniers sont couchés au sol, cherchant à éviter les balles des kalachnikovs qui visent la colonne. Pas moins de 28 impacts seront relevés sur le bouclier qui protège les hommes de la BRI. Un collègue de Thomas est touché à la main, mais la doctrine est claire : la colonne doit continuer à avancer coûte que coûte.
Tandis que les deux premiers membres de la colonne ouvrent le feu sur les terroristes, les suivants sauvent les otages. Puis, un tournant survient : l’un des terroristes descend les escaliers au bout du couloir et fait exploser sa ceinture. L’explosion projette son complice, qui meurt à son tour dans la déflagration. Aucun des otages ne sera tué.
"Qu'est ce qu'on aurait pu faire de mieux ?"
À travers ce témoignage, Thomas souhaite rappeler l’importance d’une gestion rigoureuse de l’usage des armes à feu, quel que soit le contexte : de la simple altercation jusqu’au face-à-face avec les deux terroristes du Bataclan. « J’y pense encore… Qu’est-ce qu’on aurait pu faire de mieux ? », confie-t-il. « Même si mon choix avait été validé par mon chef de groupe et qu’on est entraîné à l’usage des grenades, imaginons qu’on tue quelqu’un dans l’action… On la balance, mais on ne connaît pas toujours les conséquences. Ce jour-là, j’ai fait un choix, mais j’aurais pu en payer le prix. »
« On nous reprochera toujours quelque chose […] Le métier de policier n’est pas simple. On est toujours face à la critique, finalement », déplore l’ancien opérateur de la BRI.