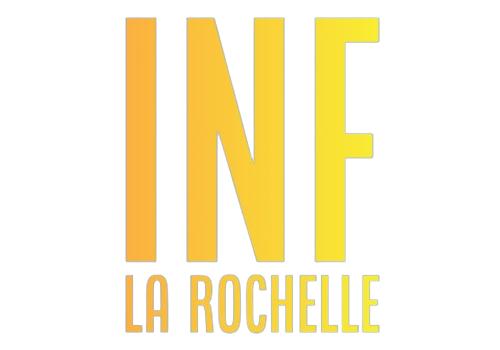La police nationale de Charente-Maritime dispose d’une équipe de quatre formateurs aguerris afin de former les policiers à l’usage des armes à feu. Une pratique qui, contrairement aux apparences, est très réglementée et s’appuie sur des textes qui peuvent s’avérer parfois très complexes. Découvrez le premier épisode de notre série sur l’usage des armes à feu dans la police nationale.

L’usage des armes à feu au sein de la police est un sujet qui revient régulièrement dans le débat public et reste souvent complexe à appréhender. Dans quel cadre peut-on ouvrir le feu ? À partir de quel moment l’usage de l’arme est-il justifié ? Quelles zones du corps peuvent être visées ? Autant de questions auxquelles doivent répondre les formateurs de la police nationale en Charente-Maritime, aussi bien auprès des nouvelles recrues que des agents expérimentés, dans un contexte où la législation reste parfois difficile à interpréter, comme nous l’explique Myriam Akkari, directrice de la police nationale en Charente-Maritime.
En 2023, selon le dernier rapport de l’IGPN (Inspection générale de la police nationale), près de 381 munitions ont été tirées par des policiers, un chiffre en baisse de 40 %. Contrairement à certaines idées reçues, l’usage des armes à feu dans la police nationale est l’une des pratiques les plus réglementées et les plus tracées. Le Sig Sauer, l’arme de poing des policiers, peut être inspecté à tout moment et chaque usage de munitions doit être déclaré. S’il en manque une, le policier détenteur de l’arme devra expliquer le tir et peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire, comme nous l’explique le brigadier-chef Mehdi Servetta, qui forme les policiers à l’usage des armes à feu.
"On est pas former pour tuer, mais pour neutraliser et stopper une menace"
Comme le précise Myriam Akkari, les policiers ne sont « pas formés pour tuer, mais pour neutraliser et stopper une menace, afin d’interpeller la personne et mener une enquête ». Mehdi Servetta explique que l’objectif est de donner une formation solide aux policiers, confrontés à des dangers continus et variés.
« L’usage de la force est interdit en France […] Pour rentrer dans le cadre de l’irresponsabilité pénale, on est obligés de justifier nos actions », explique-t-il, rappelant le cadre législatif autour de ce sujet, avec de nombreux textes qui diffèrent en fonction des situations. L’objectif est de savoir proportionner et graduer sa réponse face à la menace (usage d’un taser, d’une matraque ou d’une arme à feu), mais également de déterminer si l’usage de l’arme est réellement nécessaire selon le contexte.
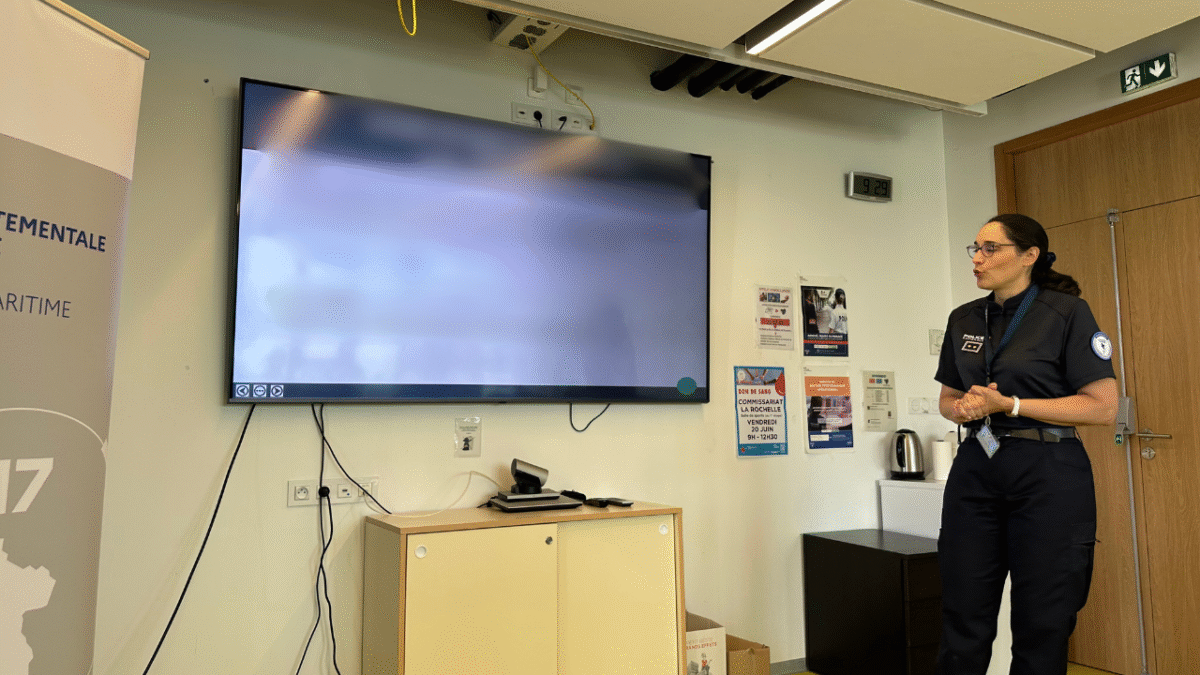
"Le simple fait de pouvoir exhiber une arme, c’est dissuasif"
« Le simple fait de pouvoir exhiber une arme, c’est dissuasif et intimidant. On doit la sortir uniquement si on est face à un danger supposé », rappelle le brigadier-chef Mehdi Servetta, qui insiste sur la graduation de la réponse face à la menace. « Il y a une notion de danger, de menace et d’atteinte (quand le policier ou un tiers est touché par une arme). En fonction du palier où l’on se trouve, la réponse ne va pas être la même […] Le taser est un moyen intermédiaire, par exemple, pour intervenir avant un drame et éviter une issue fatale, ce qui n’est pas forcément possible avec une arme de poing. »
La police utilise plusieurs catégories d’armes selon les situations, de la matraque à l’arme de poing, en passant par le taser ou le LBD (lanceur de balles de défense). Pour l’usage de chaque arme, les policiers doivent suivre une formation spécifique et les entretenir. Par exemple, pour leur arme de poing, ils doivent tirer trois fois par an (six fois pour la brigade anti-criminalité) afin de conserver leur habilitation. La formation inclut également l’usage de la matraque. Cette diversité d’armes permet une meilleure gradation de la réponse face à une menace, comme l’explique l’un des formateurs.
Un cadre d'usage qui change au fil des années
Après la vague d’attentats en 2015 et 2016, le cadre d’usage des armes à feu a été modifié pour les forces de sécurité intérieure, notamment afin d’intervenir plus efficacement face à une menace terroriste. « Il fallait une atteinte pour répliquer avant 2017. Concrètement, il fallait attendre que le terroriste engage avant que l’on puisse tirer, ce qui nous mettait en danger », déplore le formateur.
Désormais, avec l’article L435-1 du Code de la sécurité intérieure, après deux sommations, les policiers peuvent ouvrir le feu en cas de danger imminent menaçant la sécurité des personnes ou d’un bien. De même, si une personne a déjà tué plusieurs individus et risque de recommencer, les forces de l’ordre peuvent tirer afin d’éviter un nouveau drame. Au-delà de ces évolutions, un policier ne peut faire usage de son arme que s’il est dans l’exercice de ses fonctions, clairement identifiable, et en cas d’absolue nécessité, de manière strictement proportionnée. Bien entendu, un policier hors-service et qui est avec son arme peut se défendre dans le cas de la légitime défense comme nous le voyons ci-dessous.
La légitime défense des policiers
La notion de légitime concerne les situations où une ou plusieurs personnes armées menacent la vie ou l’intégrité physique des policiers ou d’un tiers. Elle s’applique également dans le cas de fuites de personnes cherchant à échapper à la garde à vue ou aux investigations, lorsqu’elles représentent une menace pour la vie des policiers ou d’autrui.
L’un des cas les plus médiatisés reste celui du refus d’obtempérer, en lien avec la fuite de véhicules, d’embarcations ou d’autres moyens de transport. Si le conducteur n’obtempère pas à un ordre d’arrêt et que lui ou ses passagers sont susceptibles de mettre en danger la vie d’autrui, les policiers peuvent faire usage de leur arme. Contrairement aux idées reçues, un policier explique que tirer sur les roues d’un véhicule lancé à pleine vitesse ne permet pas toujours de le stopper, d’où le fait que le conducteur puisse être visé lorsque la vie d’autrui est réellement menacée.
Le discernement du policier reste l’un des principaux objectifs de formation, afin qu’il prenne en compte le contexte, la nature des risques et les menaces spécifiques à chaque situation, et qu’il choisisse la réponse la plus adaptée dans les meilleurs délais, malgré le stress. « Concrètement, il faut donner aux policiers la clé du discernement », conclut Myriam Akkari.